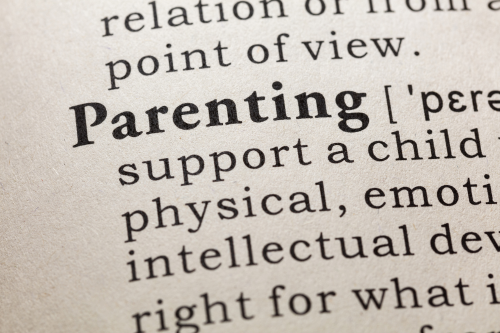Le judaïsme considère l’homme comme un être profondément relationnel : il est créé bétsélem Élokim (à l’image de Dieu) et placé dans le monde non pour vivre isolé, mais pour construire et participer à une communauté.
L’engagement communautaire n’est pas seulement une exigence sociale, mais une véritable mitsva, une voie spirituelle qui élève l’individu et sanctifie le collectif.
Comme l’enseignent nos Sages : « Kol Israël arevim ze laze » – « Tout Israël est garant l’un de l’autre » (Talmud, Sanhédrin 27b).
Cet article développera trois axes de cet engagement : l’importance d’être actif dans la vie collective (Hazakat Kehila), la nécessité de contribuer au bien-être matériel et spirituel de la communauté, et enfin l’idéal de faire de la communauté un sanctuaire de paix.
L’engagement communautaire n’est pas seulement une exigence sociale, mais une véritable mitsva, une voie spirituelle qui élève l’individu et sanctifie le collectif.
Comme l’enseignent nos Sages : « Kol Israël arevim ze laze » – « Tout Israël est garant l’un de l’autre » (Talmud, Sanhédrin 27b).
Cet article développera trois axes de cet engagement : l’importance d’être actif dans la vie collective (Hazakat Kehila), la nécessité de contribuer au bien-être matériel et spirituel de la communauté, et enfin l’idéal de faire de la communauté un sanctuaire de paix.
Être actif dans la vie collective (Hazakat Kehila)

La participation active à la vie communautaire est un fondement essentiel de la tradition juive.
Déjà dans le désert, Israël ne recevait la Torah :
qu’ »ensemble, comme un seul homme, avec un seul cœur »
(Rachi sur Exode 19:2).
L’unité et la vitalité de la communauté sont liées à l’investissement de chacun.
Le Mesillat Yesharim rappelle que la piété ne se limite pas à des pratiques individuelles, mais qu’elle inclut l’effort constant pour renforcer le bien collectif.
Ainsi, celui qui s’engage dans l’étude publique, l’organisation de prières, ou le soutien des institutions communautaires, participe à ce que les maîtres appellent Hazakat Kehila – le maintien et le renforcement de la communauté.
Rabbi Kook allait jusqu’à dire que l’âme d’Israël ne s’épanouit vraiment que dans la dimension collective, car :
« la sainteté individuelle trouve sa plénitude dans la sainteté de la collectivité ».
Contribuer au bien-être matériel et spirituel de la communauté

L’engagement communautaire inclut un double devoir : matériel et spirituel.
Matériel, car il s’agit de subvenir aux besoins des plus fragiles, conformément à la mitsva de tsédaka et à l’exhortation de la Torah :
« Tu n’endurciras point ton cœur et tu ne fermeras point ta main à ton frère pauvre » (Deutéronome 15:7).
Spirituel, car l’âme du peuple repose sur la diffusion de la Torah, la prière et l’enseignement.
Le Likoutey Moharan souligne que même les affaires matérielles, si elles sont menées avec droiture et foi, renforcent l’ensemble des mitsvot et élèvent la communauté.
Le Hovot HaLevavot rappelle de son côté que chacun est tenu d’user de ses ressources pour le bien du collectif, car :
« les dons de l’homme ne lui appartiennent pas en propre, ils lui sont confiés pour qu’il en use au bénéfice d’autrui ».
Faire de la communauté un sanctuaire de paix

La Guemara enseigne :
« Dieu n’a trouvé de réceptacle pour Sa bénédiction que la paix »
(Uktzin 3:12).
Une communauté divisée, même pleine de Torah et de mitsvot, ne peut porter de fruits durables.
À l’inverse, une communauté animée par la paix devient un sanctuaire vivant, un prolongement du Temple.
Le Tanya précise que l’unité des âmes d’Israël est fondée sur leur racine divine commune :
« Tous les Juifs sont appelés frères car leur âme s’origine dans l’unité d’un seul Dieu ».
C’est pourquoi travailler à la paix – par la bienveillance, l’écoute, la résolution des conflits – revient à révéler cette unité transcendante.
Rabbi Kook ajoutait :
« La paix ne consiste pas seulement à cesser la dispute, mais à reconnaître la lumière de chacun et à l’unir à la lumière de l’autre ».
Conclusion
Points à retenir: